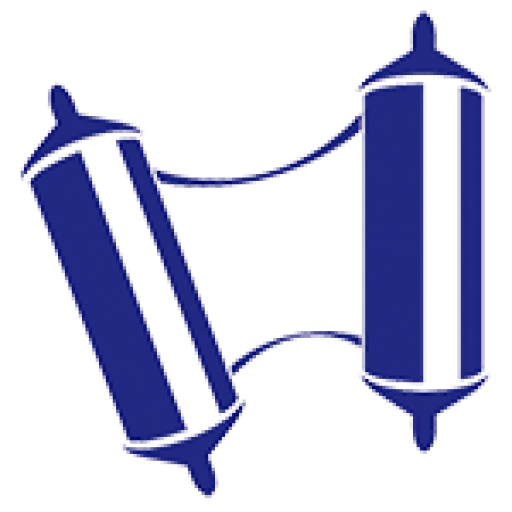Ce que le soleil doit à la lune, par le rabbin Michael Azoulay
Dans le Zohar[1], la lune symbolise la sefira[2] de Malkhout (« Royaume »), représentant l’allégeance de l’homme à Dieu, particulièrement par le biais de la pratique des mitsvot (« commandements »).
Le soleil, quant à lui, renvoie à la Binah (« Intelligence ») qui préside à la sujétion précitée, la rendant intelligible, fondée sur le savoir. Cette intelligence provient de l’examen des textes de la tradition juive, si bien que l’on ne peut que souscrire à la définition du judaïsme que donne Adin Steinsaltz, conçu comme un triptyque : des rites, des croyances (qui ne sont pas l’apanage du judaïsme, mais qui caractérisent les religions monothéistes) et l’étude des textes qui en sont à l’origine. La dite étude ayant une valeur intrinsèque, pouvant constituer une fin en soi, attestée par l’absence d’implications pratiques de nombreux sujets, ainsi que l’observe Steinsaltz dans son Guide et lexiques, en introduction à sa nouvelle édition du Talmud ; c’est dire son équivalence avec l’ensemble des commandements[3], voire sa supériorité sur la praxis[4].
Dans le Zohar, c’est la lune qui est redevable au soleil de sa lumière[5]. La raison vient éclairer la foi. D’où la question de savoir si la foi qui s’exprime en actes peut, réciproquement, enrichir la raison.
La pratique juive apporte-t-elle quelque chose de plus à la réflexion, complète-t-elle l’étude ? Mon vécu personnel rend la question inverse plus saillante : Serais-je devenu rabbin si je n’avais rencontré des maîtres qui m’avaient éveillé à l’étude? Serais-je même demeuré pratiquant si l’étude et son corolaire, l’esprit critique qu’elle développe, n’étaient venus nourrir et régénérer une tradition confinée au ritualisme, de ce fait, asséchée et asséchante ?
Cette inversion de la question accentue, en définitive, la question faisant l’objet de la présente étude : Pourquoi pratiquer alors que penser semble suffisant et souvent tellement plus gratifiant ?
Les premières lignes du monumental code de lois de Maïmonide[6], le Michneh Torah, n’évoquent-elles pas l’impératif de connaître Dieu, plutôt que celui d’y croire ?
La question de l’utilité de la pratique de la Loi déborde le cadre juif puisqu’elle oppose également juifs et chrétiens, singulièrement depuis Paul[7].
Voici quelques pistes de réflexion, dans lesquelles je me retrouve, proposées par trois penseurs juifs éminents, venant d’horizons différents : Samson Raphaël Hirsch, Abraham Heschel et André Neher[8].
Samson Raphaël Hirsch[9], afin de réfuter ceux qui prétendent que les rites seraient arbitraires et n’auraient d’autre sens que l’obéissance aveugle à Dieu, affirme, d’une part, qu’il y a du sens dans les rites, qu’ils renvoient à une symbolique (c’est précisément le rôle éclairant de l’étude), et, d’autre part et surtout, qu’une idée a besoin, pour vivre, d’être incarnée, que le meilleur moyen de la perpétuer demeure l’accomplissement de l’acte rituel. Relevant que la circoncision prescrite à Abraham, « première ordonnance de valeur symbolique spécifiquement juive », et ayant donc valeur d’exemple « pour toutes les ordonnances similaires ultérieures », se voit qualifiée, tantôt d’ « Alliance » (Bérit), tantôt de « signe d’Alliance » (ot Bérit)[10], Hirsch en déduit deux caractéristiques solidaires communes à tous les rites :
La réalisation concrète de l’acte prescrit et la perpétuation de l’idée. « Jamais la perpétuation de l’idée ne pourra se passer de la réalisation concrète, ni la remplacer. L’omission de l’acte équivaut à la négation de l’idée… D’un autre côté, le but de la réalisation de l’acte prescrit n’est pleinement atteint qu’à partir du moment où il devient un ot, un symbole… et lorsque l’idée qu’il symbolise devient vivante en nous. »[11]
Pratiquer équivaudrait donc à donner vie, à concrétiser des idées qui, si elles restaient au stade de la réflexion, demeureraient abstraites, évanescentes. Rabbi Na’hman de Bratslav (1772-1811) proposait ainsi à l’étudiant de faire de sa Torah une prière, exprimant ainsi ardemment le désir que se concrétise le savoir acquis.
On peut ajouter que parler de perpétuation d’une idée, revient à parler de transmission.
Or, en matière d’éducation juive, la transmission ne passe-t-elle pas d’abord et avant tout par les rites, du fait de leur « visibilité », plus que par le sens que nous leur donnons, toujours discutable et discuté ?
Ainsi, les sages du Talmud proposent plusieurs définitions du ‘am haarets (« ignorant ») qu’ils ont en horreur. Il en est une étonnante mais pertinente : un ‘am haarets ce peut être un érudit auquel il manque la fréquentation d’un maître qui vit ce qu’il dit. Un maître qui enseigne plus par ce qu’il est que par ce qu’il énonce.
Abraham Heschel[12] cite un passage célèbre du Talmud où un hérétique reproche aux juifs d’avoir accepté la Torah avant de l’avoir écouté, en référence au verset non moins célèbre de l’Exode (XXIV, 7) : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et l’écouterons ». Dans un chapitre consacré au sérieux des actes, de leurs répercussions et de ce qu’ils disent de ce que nous sommes, Heschel souligne que « nous n’avons pas foi à cause de nos actes, mais nous pouvons atteindre la foi à travers les actes sacrés. »
Donnons-nous parce que nous sommes généreux, ou devenons-nous généreux parce que nous donnons ? Mesure-t-on suffisamment combien nos actions nous façonnent, en bien comme en mal ? Ainsi, Maïmonide, dans ses lois relatives à la charité, recommande au donateur de répartir en plusieurs dons une somme affectée à la tsedaqah plutôt que de la remettre en une seule fois, la répétition du geste oblatif agissant sur son caractère. Jusqu’à ce que la générosité devienne pour lui une sorte de seconde nature.
Surtout, il affirme que « la pensée juive se découvre par la vie juive ». « Il serait futile, par exemple, d’analyser la signification de la Musique sans écouter de la musique »[13].
Appliqué à la vie juive, l’exemple souvent cité fort à propos comme argument tiré de l’expérience, est celui du chabbat.
Peut-on en effet comprendre ce jour singulier, en percevoir le caractère désaliénant, sans le vivre ?
Enfin, pour André Neher[14], si les rites tiennent une place si fondamentale dans le judaïsme, c’est parce que l’une des « idées maîtresses » de celui-ci, « c’est l’importance de tout, de chaque geste, de chaque mot, de chaque pensée des hommes… Car le rite juif, complexe et multiforme, aussi varié que la vie elle-même, oblige à prendre conscience du fait que tout ce que nous faisons a une valeur, que rien n’est sans importance. »
Neher ne nie pas le caractère symbolique du rite, mais il estime qu’ « il est avant tout réalité », et que « tout acte laisse une cicatrice dans la réalité de la vie ».
La concrétude du rite, son effet structurant, s’opposent à l’intelligence et à la réflexion, fondamentalement abstraites. Ordre du rite face au chaos de la pensée. Tout au moins avant qu’elle ne soit traduite en acte. Neher convoque la psychanalyse et ce qu’elle nous dit de ces actes qui conditionnent et nous conditionnent, qui expriment ce que nous sommes, nous révèlent souvent à nous-mêmes bien plus que nos pensées.
En conclusion, l’observance religieuse devient, plus qu’un complément à l’étude, étude elle-même et « boussole de l’homme engagé », qui y trouve une source de repères dans le temps et dans l’espace (Neher). Car la pratique religieuse intègre le savoir dans le tissu de nos existences, et parce qu’une part indéniable de la compréhension des rites réside dans leur pratique même.
[1] Ouvrage essentiel de la mystique juive, attribué par la tradition juive à un maître de la tradition orale du IIème siècle, Siméon ben Yo’haï.
[2] Les sefirot, au nombre de dix, expriment la volonté et la pensée divines, ainsi que les relations de Dieu avec le monde créé.
[3] Cf. Péah, 1,1.
[4] Le Talmud (de Babylone, traité Qiddouchin, p. 40b), à la question de savoir qui de l’étude ou de la pratique prime, opte pour l’étude.
[5] Le Zohar et le Talmud comparent, par exemple, la relation entre Moïse le maître et Josué son disciple, au soleil et à la lune.
[6] Rabbi Moïse ben Maïmon (11 35 ou 1138-1204).
[7] Paul (entre 5 et 15- vers 62 ou 67), apôtre, auteur de quatorze Epîtres du Nouveau Testament.
[8] Dont l’ouvrage, L’identité juive, Editions Payot & Rivages, p. 156-165, Paris, 2007, a nourri la présente réflexion.
[9] Rabbin allemand (1808-1888).
[10] Voir Genèse, XVII, 10-11.
[11] Rabbi Schimchon Raphaël Hirsch, Commentaire du Pentateuque, 1868. Traduction de Ne’hémia Ganloff.
[12] Abraham Joshua Heschel (1907-1972), érudit et philosophe de la religion, polonais de naissance avant d’émigrer aux Etats-Unis.
[13] Abraham Heschel, Dieu en quête de l’homme (philosophie du judaïsme), Paris, 1968, p. 298-300.
[14] André Neher (1914-1988). Impossible de résumer ici la fécondité de cet intellectuel et homme d’actions français (avant d’émigrer en Israël en 1967), qui a tant contribué au renouveau de la pensée juive dans la seconde moitié du XXème siècle.